Le 12 octobre 2004, alors qu’il est cantonné dans son quartier
général à Ramallah depuis plus de deux ans, le président palestinien
Yasser Arafat
se plaint auprès de son entourage de fortes douleurs intestinales. Dans
les jours qui suivent, son état de santé se dégrade rapidement et,
malgré un transfert à l’hôpital militaire de Percy (Clamart, France) le
29 octobre, ne s’améliorera pas. Il est déclaré mort le 11 novembre,
d’une «
hémorragie cérébrale ».
Onze ans plus tard, les questions demeurent.
Arafat
a-t-il été empoisonné ? Si oui, par qui et pour quelles raisons ?
Plusieurs hypothèses circulent, diverses expertises et contre-expertises
ont été réalisées, sans qu’aucun résultat définitif ne puisse être
obtenu. Quand bien même la plupart des médecins s’accordent à dire que
la mort du
raïs n’a pas été «
naturelle », aucun d’entre eux ne se risque à affirmer avec certitude qu’
Arafat a été empoisonné.
L’objet de cet article n’est pas tant de revenir de manière exhaustive sur les «
épisodes » scientifiques et judiciaires de «
l’affaire »
que de tenter d’expliquer ce que les modalités des investigations et la
pluralité des thèses en présence révèlent quant à l’actualité de la
question palestinienne.
«
L’affaire Arafat » est en effet à bien des égards un condensé des dynamiques en cours en Palestine : faillite du «
processus de paix », crise historique du mouvement national, rivalités – souvent dépolitisées – entre cliques palestiniennes.
Enquêtes tardives, absence de conclusions
scientifiques définitives
Il aura fallu attendre plus de six ans pour qu’une commission d’enquête palestinienne soit mise en place, dirigée par
Tawfiq al-Tirawi, ancien officier du renseignement et proche de
Yasser Arafat. À l’heure où ces lignes sont écrites, elle n’a toujours pas rendu de conclusion définitive, même si
Tarawi
a répété à de nombreuses reprises que la thèse de l’empoisonnement ne
faisait selon lui aucun doute. Force est toutefois de constater que du
côté palestinien, les investigations ont été tardives et, jusqu’à ce
jour, peu concluantes (mardi 10 novembre 2015,
Tawfiq al-Tirawi a déclaré que la commission d’enquête palestinienne avait réussi à identifier l’assassin d’Arafat et qu’«
Israël était responsable », sans donner de détail).
C’est en réalité une enquête menée par le journaliste états-unien
Clayton Swisher pour le compte d’
Al Jazeera, à partir de la fin de l’année 2011, qui va remettre «
l’affaire Arafat » sur le devant de la scène. Cette enquête, qui débouche sur le documentaire
« What Killed Arafat ? »,
diffusé en juillet 2012 sur la chaîne qatarie, conclut, sur la base
d’expertises suisses réalisées sur des effets personnels d’
Arafat, à l’empoisonnement du
raïs, avec notamment des relevés mesurant des taux de polonium 210 «
largement supérieurs à la normale ».
Elle convainc – semble-t-il – la veuve d’
Arafat,
Souha,
qui avait fourni les objets analysés par les équipes scientifiques
suisses, de porter plainte contre X devant la justice française (
Souha Arafat possède la double nationalité), pour assassinat.
Les choses s’accélèrent alors, et des expertises sont réalisées en 2012-2013, avec exhumation du corps d’
Arafat
en novembre 2012. Mais les conclusions des trois équipes de
scientifiques – russes, français, suisses – sont divergentes, voire même
contradictoires : alors que les Français concluent à une «
mort naturelle » et que les Russes affirment que les traces de polonium 210 relevées sur la dépouille et dans la sépulture d’Arafat sont «
insignifiantes », les Suisses considèrent que les résultats des tests encouragent à «
soutenir raisonnablement l’hypothèse d’un empoisonnement ».
La controverse sur le terrain médical (les taux de radiation relevés
par les trois équipes sont différents, ainsi que leurs interprétations)
se déplace rapidement sur le terrain politique : pour les partisans de
la thèse de l’empoisonnement, parmi lesquels
Tirawi et
Al Jazeera (qui diffuse en novembre 2013
« Killing Arafat »,
un documentaire appuyant les conclusions suisses), les équipes russes
et françaises sont soumises à un agenda diplomatique qui excède les
seules compétences des chercheurs, et tentent d’«
enterrer l’affaire ».
La France est en effet, depuis plusieurs années, dans une dynamique
de rupture avec un certain héritage gaulliste et de rapprochement avec
l’État d’Israël, qui se manifeste notamment par les hésitations de
François Hollande à voter en faveur de l’admission de l’État de Palestine à l’
ONU
en novembre 2012 ou, lors des bombardements sur Gaza à l’été 2014, par
une première déclaration reprenant terme à terme les arguments de
Benyamin Netanyahou.
Confirmation de cette thèse ? En septembre 2015, les juges français
saisis de la plainte pour assassinat prononcent une ordonnance de
non-lieu, suivant les réquisitions du parquet de Nanterre, et ce malgré
les demandes répétées des avocats de
Souha Arafat d’organiser davantage d’expertises. Les juges estiment qu’il n’est «
pas démontré que M. Yasser Arafat ait été assassiné par empoisonnement au polonium 210, et [qu’]
il n’existe pas de preuve suffisante de l’intervention d’un tiers qui aurait pu attenter à [sa]
vie ». La veuve du
raïs a fait appel de cette décision, ses avocats estimant que les juges ont agi dans la «
précipitation ».

Le
29 octobre 2004, avion de la République française, en provenance
d’Amman, se pose sur l’aéroport militaire de Villacoublay, non loin de
Paris. Le leader palestinien en descend soutenu par des proches. Un
incident diplomatique survient dès que la délégation palestinienne pose
le pied sur le sol français : les gardes du corps d’Arafat doivent
remettre leurs pistolets automatiques aux policiers français…
À l’heure actuelle, la situation est donc des plus floues.
Les conclusions suisses convainquent la majorité des chercheurs et médecins, même si elles sont sujettes à caution du fait du délai écoulé entre la mort d’
Arafat
et les expertises. Mais aucune commission d’enquête indépendante ou
aucune instance judiciaire n’a conclu définitivement à l’assassinat.
Toutes les rumeurs et tous les fantasmes sont dès lors permis, qui
révèlent, au même titre que la confusion qui accompagne les diverses
expertises, que «
l’affaire Arafat » a des implications éminemment politiques.
La crédibilité politique des thèses en présence
En effet, au-delà des controverses scientifiques sur lesquelles nous
n’entendons pas nous prononcer ici, n’ayant pas d’éléments nouveaux à
apporter, la persistance du doute et la survivance de la thèse de
l’empoisonnement sont en elles-mêmes riches de sens. Plus intéressant
encore, la pluralité des hypothèses en présence et l’instrumentalisation
qui est faite, côté palestinien, de «
l’affaire Arafat », en disent long sur la profondeur de la crise que traverse le mouvement national palestinien, à commencer par l’
OLP elle-même.
L’évidence voudrait en effet que si empoisonnement il y a eu, il soit
l’œuvre des services israéliens. Les arguments allant à l’appui de
cette thèse sont nombreux :
- Ce ne serait pas la première fois que l’État d’Israël déciderait de
se débarrasser d’un dirigeant palestinien. De l’élimination des cadres
de l’OLP dans les années ’70 et ’80, y compris en Europe, aux « assassinats ciblés » dans les territoires occupés durant les années ’90 et 2000, en passant par la tentative d’empoisonnement de Khaled Mechaal en 1997 en Jordanie, les exemples sont légion.
- En 2004, Yasser Arafat n’était plus considéré par Israël comme un « partenaire », mais au contraire comme un adversaire. Comparé à Ben Laden par un Ariel Sharon
alors au sommet de son influence politique, il était depuis plus de
deux ans confiné dans son QG, et les États-Unis comme Israël étaient à
la recherche de responsables palestiniens plus enclins à courber
l’échine, que la centralité du raïs dans le champ politique palestinien empêchait d’émerger.
- L’hypothèse de l’assassinat d’Arafat fut discutée
ouvertement dans les hautes sphères israéliennes, avec multiplication
des menaces et des déclarations belliqueuses, à l’instar d’Ariel Sharon déclarant en 2002 qu’il « regrettait de ne pas avoir liquidé Arafat » au Liban.
Cependant, malgré ces évidences, une autre thèse s’est rapidement
imposée comme crédible chez les Palestiniens – et les observateurs –
convaincus de l’empoisonnement : celle d’un règlement de comptes «
interne », et donc de la suppression d’
Arafat
par des dirigeants palestiniens rivaux, souhaitant se débarrasser d’un
leader omniprésent, voire omnipotent. Et les concurrents étaient
nombreux, ainsi que les appétits,
a fortiori à partir du moment
où des espaces semblaient s’ouvrir avec la mise hors jeu du président
palestinien et la quête israélo-états-unienne de nouveaux
interlocuteurs.
Il suffit pour s’en convaincre de se souvenir du déroulement du
congrès du Fatah en août 2009,
durant lequel les tensions internes et l’existence de groupes rivaux
avaient éclaté au grand jour : scrutin contesté, modalités d’élection de
la direction décriées, marginalisation des cadres les plus militants au
profit des technocrates de l’
Autorité palestinienne
(AP), etc. Des phénomènes qui s’inscrivaient dans la continuité des
développements à l’œuvre durant les années 2000, avec la multiplication
des règlements de comptes entre bandes armées liées au
Fatah
soutenant tel ou tel baron local, ou encore le désastre des élections
législatives de 2006 où l’on avait compté, dans certaines
circonscriptions, plus d’une dizaine de candidats concurrents issus du
Fatah.
La mort d’Arafat comme révélateur et accélérateur de la crise

Shaul Mofaz en 2003 : «Soyez certain que les jours d’Arafat sont comptés…»
D’où le crédit apporté à une troisième thèse, qui se situe à
mi-chemin entre les deux premières : celle d’un acte perpétré par un
clan palestinien agissant de concert avec l’État d’Israël. Le nom de
Mohammad Dahlan, ancien responsable de la Sécurité préventive à
Gaza connu pour son carriérisme, ses réseaux de corruption/clientèle et ses liens «
privilégiés »
avec Israël, revient régulièrement chez les partisans de cette
troisième version. À plus forte raison depuis que le Hamas a rendu
publique, à l’été 2007, une
lettre découverte dans le bureau de
Dahlan après la
tentative de putsch manquée dans laquelle il était largement impliqué. Dans cette lettre datée de 2003 et adressée à
Shaul Mofaz, alors ministre israélien de la Défense,
Dahlan écrit : «
Soyez
certain que les jours de Yasser Arafat sont comptés, mais laissez-nous
en finir avec lui selon nos méthodes, pas selon les vôtres. Et soyez
également assuré que […]
je donnerai ma vie pour tenir les promesses que j’ai faites devant le président Bush ».
Dahlan n’a jamais contesté l’authenticité de la lettre.
Élément troublant : alors que la lettre a été rendue publique en juillet 2007, les responsables du
Fatah et de l’
AP se sont, à de rares exceptions près, abstenus de tout commentaire. Ce n’est qu’en mars 2014 que
Mohammad Dahlan a été explicitement montré du doigt par le président palestinien
Mahmoud Abbas lors d’une réunion de l’
OLP. Mais qui connaît un tant soit peu l’histoire récente de l’
OLP sait que ces accusations se situent elles aussi dans une démarche de règlements de comptes :
Abbas et
Dahlan
ont en effet été très proches durant les années 2000, le premier
imposant même le second comme ministre de la Sécurité intérieure en
2003, malgré les objections d’
Arafat.
Ce n’est qu’à partir du moment où
Dahlan s’est remis à voler de ses propres ailes qu’il a fait l’objet de la réprobation d’
Abbas et d’accusations diverses (corruption, détournement de fonds, responsabilité dans divers assassinats, entre autres).
Souha Arafat a pour sa part accusé
Mahmoud Abbas et ses proches de désigner
Mohammad Dahlan pour éviter que l’enquête n’aille trop loin et que les responsabilités du premier cercle, celui de l’entourage d’
Arafat, ne soient établies, à quoi certains cadres de l’
OLP ont répondu que les motivations de
Souha Arafat étaient essentiellement pécuniaires…
Une grande confusion donc, qui tient notamment au fait que jusqu’à sa mort,
Yasser Arafat se situait dans une position paradoxale : sa centralité dans les appareils du
Fatah, de l’
OLP et de l’
Autorité palestinienne
en faisait un élément incontournable et indéboulonnable, qui
garantissait dans le même temps une certaine cohésion interne. Sa mort,
qu’elle ait été provoquée ou non par des éléments palestiniens, a libéré
un nombre considérable de forces centrifuges, ce qui a eu pour effet,
tout en ouvrant de nouveaux espaces, d’accélérer les logiques
d’implosion au sein du
Fatah, de l’
Autorité palestinienne et, plus généralement, du mouvement national palestinien.
Logiques dont ont bénéficié, directement ou indirectement, l’État
d’Israël, renforcé par les divisions inter-palestiniennes, et certaines
baronnies palestiniennes, qui ont pu s’affirmer dans l’appareil de l’
AP et développer leurs réseaux de clientèle.
Ainsi, la thèse d’un acte «
co-organisé » a le mérite de
fournir une explication s’abstrayant de tout campisme : qu’elle soit ou
non avérée, elle met en lumière, par la crédibilité de certains
arguments avancés et par la confusion qu’elle sème dans le camp
palestinien, la complexité de la situation interne et
l’état de décomposition avancée du mouvement national palestinien « historique » *.
La lenteur de la mise en place de la commission d’enquête palestinienne, son incapacité à faire avancer le «
dossier » – rendue d’autant plus visible par les résultats et les conséquences des enquêtes d’
Al Jazeera
– et sa réticence à formuler une quelconque conclusion sont
révélatrices de la crise du mouvement national, y compris du côté du
Hamas, peu vindicatif sur cette « affaire ». Entre les partisans de «
l’unité » à tout prix (qui refusent d’accuser des Palestiniens), les adeptes du «
processus de paix » (qui souhaitent ménager les interlocuteurs israéliens), et les tenants de la «
table rase »,
aucun compromis n’est possible, d’autant plus que ces positionnements
antagoniques se doublent de rivalités – dépolitisées – entre cliques.
Ainsi, onze ans après sa mort,
Yasser Arafat
continue de hanter les esprits et de peser de tout son poids sur la vie
politique palestinienne. Son absence/présence est d’autant plus
ressentie depuis quelques semaines que l’on assiste de nouveau à un
soulèvement dans les territoires occupés, que le leadership traditionnel
est dans l’incapacité de structurer ou d’encadrer. Cette inaptitude à
offrir un cadre et des perspectives politiques à la jeunesse révoltée
participe d’une crise profonde de l’ensemble du champ politique
palestinien, qui ne pourra commencer à se résoudre que lorsque ce
dernier aura définitivement acté la mort d’un «
processus de paix »
qu’il serait grandement temps d’autopsier : une autopsie que certains
veulent à tout prix éviter tant ils s’accrochent aux avantages matériels
et symboliques que leur procure le maintien des structures et des
illusions d’
Oslo, quand bien même le projet d’État
palestinien est, à l’instar de celui qui l’a incarné pendant plusieurs
décennies, mort et enterré.
Cet article a été publié par «
Middle East Eye » (édition française)
 Julien Salingue est docteur en Science politique, spécialiste de la question palestinienne.
Il est l’auteur, entre autres, d’
Julien Salingue est docteur en Science politique, spécialiste de la question palestinienne.
Il est l’auteur, entre autres, d’À la recherche de la Palestine
(2011) et La Palestine d’Oslo
(2014), et a co-dirigé Israël : un État d’apartheid ?
(2013).
 Son dernier ouvrage en date, La Palestine des ONG, paraîtra le 13 novembre 2015 (éditions La Fabrique).
Il y analyse comment les ONG contribuent à pallier les déficits du
pseudo-«processus de paix» et les mécanismes qui ont conduit des
organisations à l’origine militantes (dans les années 1970-1980) à
devenir des prestataires de services au sein d’un simili-État avec
l’appareil duquel elles entretiennent des rapports complexes. Les ONG «
Son dernier ouvrage en date, La Palestine des ONG, paraîtra le 13 novembre 2015 (éditions La Fabrique).
Il y analyse comment les ONG contribuent à pallier les déficits du
pseudo-«processus de paix» et les mécanismes qui ont conduit des
organisations à l’origine militantes (dans les années 1970-1980) à
devenir des prestataires de services au sein d’un simili-État avec
l’appareil duquel elles entretiennent des rapports complexes. Les ONG « jouent
un rôle fonctionnel essentiel dans l’offensive symbolique qui vise à
transformer les Palestiniens, peuple avec des droits, en individus avec
des besoins
»

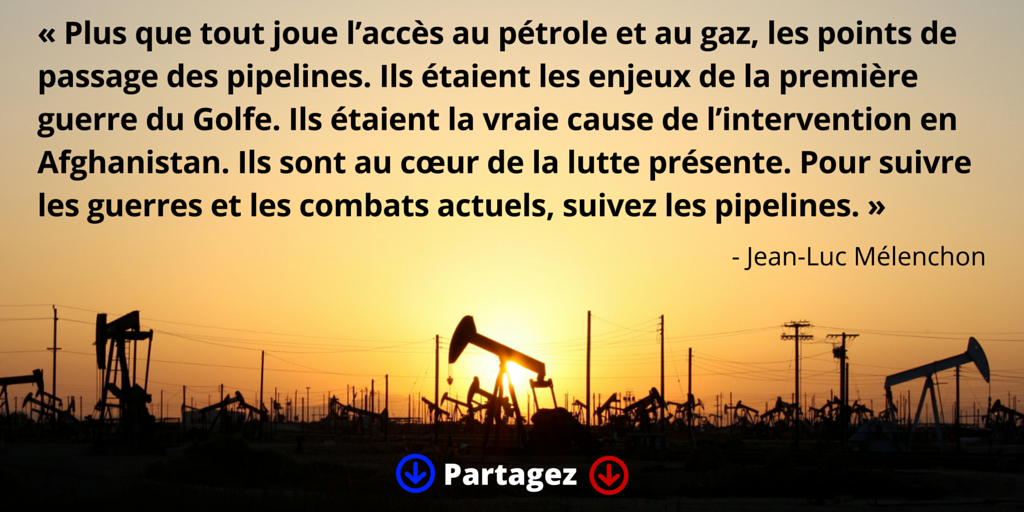




 Par
Nahed Al-Husseini. Elle est chef du bureau pour Veterans Today à Damas.
Elle est membre de l’Institut américain d’études stratégiques du
Moyen-Orient (États-Unis) et sert aussi en tant de directrice adjointe
du Congrès arabo Américain et Musulman (Detroit, États-Unis). Elle
possède un diplôme de littérature anglaise obtenu à Damas en 1987. Elle a
travaillé aussi comme journaliste freelance pour CNN, CBS, ABS en
Syrie. Elle a aussi été journaliste pour le journal turc Aydinlik et de
nombreuses autres agences. Elle parle couramment l’anglais et l’arabe.
Par
Nahed Al-Husseini. Elle est chef du bureau pour Veterans Today à Damas.
Elle est membre de l’Institut américain d’études stratégiques du
Moyen-Orient (États-Unis) et sert aussi en tant de directrice adjointe
du Congrès arabo Américain et Musulman (Detroit, États-Unis). Elle
possède un diplôme de littérature anglaise obtenu à Damas en 1987. Elle a
travaillé aussi comme journaliste freelance pour CNN, CBS, ABS en
Syrie. Elle a aussi été journaliste pour le journal turc Aydinlik et de
nombreuses autres agences. Elle parle couramment l’anglais et l’arabe.










Commentaire : Le soutien de l'Axe du mal à Daesh est, chaque jour, de plus en plus apparent.