La « résistance non-violente » palestinienne et l’appel au Boycott d'Israël
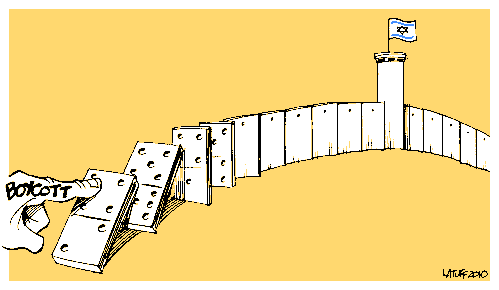 Depuis septembre 2000 et le début de ce que l’on a nommé « deuxième Intifada »,
l’une des approches dominantes dans l’appréhension du conflit
opposant l’État d’Israël au peuple palestinien est celle du « cycle de
la violence » : les violences des uns
succèderaient aux violences des autres, l’enjeu majeur serait donc
la rupture du « cycle opération armée israélienne/représailles
palestiniennes » (ou l’inverse). Ainsi se succèdent, de
manière cyclique également, les appels à « l’arrêt des violences »,
posé comme préalable au dialogue en vue d’hypothétiques négociations
entre les deux parties. Il ne s’agira pas ici de
discuter de la pertinence d’une approche qui place sur le même plan
la « violence » d’un État constitué, possédant une armée suréquipée et
l’arme nucléaire, et celle d’un peuple en
lutte pour son indépendance. Il s’agira plutôt d’interroger les
angles morts, les points aveugles d’une telle approche, et de se
demander dans quelle mesure le discours dominant sur
« la » violence dans les territoires occupés reconfigure, à
l’extérieur, la perception de la lutte nationale du peuple palestinien
et, à l’intérieur, la résistance palestinienne
elle-même.
Depuis septembre 2000 et le début de ce que l’on a nommé « deuxième Intifada »,
l’une des approches dominantes dans l’appréhension du conflit
opposant l’État d’Israël au peuple palestinien est celle du « cycle de
la violence » : les violences des uns
succèderaient aux violences des autres, l’enjeu majeur serait donc
la rupture du « cycle opération armée israélienne/représailles
palestiniennes » (ou l’inverse). Ainsi se succèdent, de
manière cyclique également, les appels à « l’arrêt des violences »,
posé comme préalable au dialogue en vue d’hypothétiques négociations
entre les deux parties. Il ne s’agira pas ici de
discuter de la pertinence d’une approche qui place sur le même plan
la « violence » d’un État constitué, possédant une armée suréquipée et
l’arme nucléaire, et celle d’un peuple en
lutte pour son indépendance. Il s’agira plutôt d’interroger les
angles morts, les points aveugles d’une telle approche, et de se
demander dans quelle mesure le discours dominant sur
« la » violence dans les territoires occupés reconfigure, à
l’extérieur, la perception de la lutte nationale du peuple palestinien
et, à l’intérieur, la résistance palestinienne
elle-même.
La
confusion entre « violence » et « action militaire ponctuelle » occulte
l’essentiel
de la violence infligée par Israël au peuple palestinien : celle de
l’occupation militaire, continue depuis juin 1967. Effet de miroir, la
résistance palestinienne est appréhendée en étant
amputée de l’essentiel : le combat quotidien contre l’arbitraire de
l’administration coloniale. Cette invisibilisation de leur lutte a
conduit les Palestiniens à envisager, au cours de leur
histoire récente, des moyens d’action complémentaires afin de rompre
leur isolement et de renverser un rapport de forces largement
défavorable. Ainsi, depuis quelques années la thématique de la
« résistance non-violente » occupe une place substantielle dans le
champ politique palestinien et dans le mouvement international de
solidarité. L’appel international au Boycott, au
Désinvestissement et aux Sanctions contre Israël (BDS), s’inscrit
dans cette logique, que l’on retrouve également dans
l’internationalisation de la lutte des villageois de Bil’in contre la
construction du mur(1). Dans quelle mesure la « résistance
non-violente » est-elle en rupture avec les formes passées de la lutte
palestinienne ? La « non-violence »
revêt-elle la même signification pour les Palestiniens et pour ceux
qui affirment les soutenir dans leur combat ? En dernière analyse,
l’apparent développement de la « non-violence »
traduit-il une réorientation stratégique de la lutte ou un
changement tactique pour reconquérir une légitimité ?
I) De la non-violence dans les territoires palestiniens occupés
Définir
la non-violence requiert une définition de la violence, que l’on pourra
considérer dans notre contexte
comme l’utilisation de la force physique dans le but de provoquer
chez autrui des dommages corporels et/ou psychologiques, voire la mort.
Une « action non-violente » n’est cependant pas
seulement une action qui ne répond pas à ces critères. Elle est à
situer dans un contexte de violence réelle ou potentielle. On pourra
donc l’envisager comme « un substitut direct aux
comportements violents, [qui] implique une retenue délibérée face à
une violence attendue dans un contexte de dispute »(2). Israël (et
auparavant le mouvement sioniste) et les Palestiniens
sont dans une situation conflictuelle depuis plus d’un siècle, dont
l’enjeu majeur est le contrôle de la terre. Et si la résistance à ce que
les Palestiniens considèrent comme une entreprise de
dépossession est bien, comme l’affirme Hussam Khadr, « une
résistance quotidienne qui a duré tout au long du 20ème
Siècle et qui dure encore aujourd’hui »(3), force est de
constater que le recours à des formes d’actions violentes, s’il a
été bien réel, n’occupe qu’une place très minoritaire dans l’histoire de
la lutte palestinienne(4).
Dans
les années 1930 des cellules de guérilla se constituent pour lutter
contre l’occupation britannique et la
colonisation sioniste. Elles seront démantelées dans les années
1936-1939. La « lutte armée » reprend en 1965, mais les actions
militaires sont relativement rares et organisées depuis
les camps de Jordanie et du Liban. L’écrasement des camps de
Jordanie (1970) puis du Liban (1982) sonne le glas de la guérilla. Les
détournements d’avion des années 1970, comme la prise d’otages
de Munich (1972), sont organisés par des groupes minoritaires et
visent avant tout à attirer l’attention internationale sur la question
palestinienne. Ces actions violentes, bien réelles, ne se
sont pas substituées à la résistance quotidienne, « non-violente » :
« Depuis plus d’un siècle la résistance civile a toujours été une
composante essentielle de la lutte du
peuple palestinien contre le sionisme. (…) La résistance au projet
colonial sioniste a principalement pris des formes non-violentes : des
manifestations de masse, des mobilisations populaires,
des grèves de travailleurs, le boycott des produits sionistes, et la
résistance culturelle, souvent ignorée, au travers de la poésie, de la
littérature, de la musique, du théâtre ou de la
danse »(5).
Les
années 1970 et 1980 ont été le théâtre du développement, dans les
territoires palestiniens occupés, de
multiples cadres d’organisation de la lutte : syndicats,
organisations d’agriculteurs, de femmes, d’étudiants, d’intellectuels,
d’artistes… Le leitmotiv de ces organisations était le
suivant : dans une situation d’administration coloniale, développer
au maximum les structures permettant de s’émanciper de la tutelle
israélienne, avec pour but l’autosuffisance (économique,
alimentaire) et la constitution d’alternatives aux structures de
l’Etat colonial (Universités palestiniennes par exemple)(6). C’est ce
travail de construction des structures de résistance dans
toute la société palestinienne qui explique le caractère massif,
organisé « à la base », durable et « non-violent » de l’Intifada
de 1987. Considérer cette dernière
comme une rupture n’est possible que si l’on résume la lutte
palestinienne aux actions violentes des années 60-70. Si l’on prend en
compte les multiples structures de résistance civile,
« non-violente », développées dans cette même période, l’Intifada n’est rien d’autre que leur « visibilisation », l’affirmation de l’existence d’un peuple en lutte
collective pour ses droits(7).
Les effets de l’Intifada
sont connus : la rhétorique israélienne qui affirmait que les
Palestiniens
n’étaient pas un peuple et que leur résistance était le fait
d’organisations terroristes perd alors une grande partie de sa
légitimité. Sous pression
internationale (et notamment états-unienne), Israël est contraint
d’ouvrir des négociations avec les Palestiniens, qui aboutiront sur les
accords d’Oslo. Aujourd’hui encore, dans la
mémoire collective palestinienne, l’Intifada de 1987
demeure la référence en termes d’organisation de la lutte et de rupture
de l’isolement international, et ce malgré l’échec du
processus d’Oslo. Les attentats-suicide des années 1990-2000 et la
période de lutte armée de 2000-2004 ne sont en aucun cas considérés
comme plus efficaces ou comme pouvant se substituer à la
lutte civile, populaire, « non-violente », dont la reconstruction
s’avère être la préoccupation majeure de tous ceux et toutes celles qui,
chez les Palestiniens, se posent la question
du redéveloppement de la résistance. La thématique de la
« résistance non-violente », entendue comme une forme d’action politique
qui, malgré une situation de conflit et une politique
violente de la part de l’autre partie, se refuse au recours à la
force physique en vue d’infliger des dommages à l’adversaire, n’est donc
pas nouvelle dans les territoires palestiniens. Elle est
le fondement même de la lutte palestinienne. Comment dès lors
comprendre les appels répétés aux Palestiniens, tant de la part des
acteurs étatiques internationaux que du « mouvement de
solidarité », à renoncer à la violence, à privilégier la
non-violence ?
II) Quelle « non-violence » ?
 On peut distinguer, chez les théoriciens et les adeptes de la non-violence, deux grandes postures : la non-violence comme
principe philosophique, découlant d’un rejet a priori de
toute forme d’action violente ; la non-violence comme choix pragmatique,
résultant d’une évaluation de divers modes d’action
dans un cas précis et un contexte donné. Gandhi est probablement le
plus célèbre « philosophe de la non-violence », tandis que Gene Sharp,
parfois surnommé, le « Clausewitz de
la lutte non-violente », incarne la non-violence pragmatique. Tandis
que Gandhi écrit « [que] la non-violence est la loi de notre espèce
tout comme la violence est la loi de
l’animal »(8), se situant délibérément sur le terrain moral, Gene
Sharp affirme que la non-violence est « une réponse à la question de
savoir comment agir avec efficacité en
politique »(9). Les deux approches peuvent bien évidemment être
combinées, et revêtent ici essentiellement un caractère idéal-typique.
On pourra néanmoins aisément comprendre que si
l’approche morale et l’approche pragmatique peuvent parfois
coexister, elles peuvent aussi se révéler contradictoires.
On peut distinguer, chez les théoriciens et les adeptes de la non-violence, deux grandes postures : la non-violence comme
principe philosophique, découlant d’un rejet a priori de
toute forme d’action violente ; la non-violence comme choix pragmatique,
résultant d’une évaluation de divers modes d’action
dans un cas précis et un contexte donné. Gandhi est probablement le
plus célèbre « philosophe de la non-violence », tandis que Gene Sharp,
parfois surnommé, le « Clausewitz de
la lutte non-violente », incarne la non-violence pragmatique. Tandis
que Gandhi écrit « [que] la non-violence est la loi de notre espèce
tout comme la violence est la loi de
l’animal »(8), se situant délibérément sur le terrain moral, Gene
Sharp affirme que la non-violence est « une réponse à la question de
savoir comment agir avec efficacité en
politique »(9). Les deux approches peuvent bien évidemment être
combinées, et revêtent ici essentiellement un caractère idéal-typique.
On pourra néanmoins aisément comprendre que si
l’approche morale et l’approche pragmatique peuvent parfois
coexister, elles peuvent aussi se révéler contradictoires.
« Nous
vivons sous occupation depuis plus de 40 ans. La violence est là, elle
est partout, dans chaque
aspect de nos vies… La non-violence ? Ca ne peut pas exister
ici »(10). Ces propos d’un militant palestinien sont éclairants : les
brutalités et les humiliations quotidiennes de
l’armée d’occupation, l’arbitraire colonial, les milliers de morts
et les dizaines de milliers de blessés… font de la vie dans les
territoires palestiniens un combat permanent contre la violence.
La violence est la règle, la norme, elle est ressentie par les
Palestiniens comme un état de fait. L’omniprésence, dans les rues, les
maisons et les échoppes palestiniennes, des affiches de
« martyrs »(11), participe de ce phénomène. Ces affiches, au-delà de
l’hommage rendu aux victimes sont un des éléments de l’environnement de
violence quotidienne dans lequel vit la
population palestinienne. On pense ici au punctum de Roland Barthes, cet élément d’une photo « qui part de la scène, comme une flèche, et vient me percer »(12) : même dans
les moments de relatif apaisement de la tension militaire, ces affiches jouent un rôle de piqûre de rappel.
Le
recours à la violence n’est donc pas perçu comme une option mais comme
une donnée de la situation, imposée par
l’adversaire. Pour nombre de Palestiniens, qu’ils aient choisi ou
non de rejoindre des « groupes armés », le recours à des actions
violentes est une question de survie. Au-delà, le
sentiment d’être une victime qui se défend face à un agresseur
conforte les Palestiniens dans l’idée que rien ne peut remettre en
question, en principe, la violence nécessaire de leur combat
légitime. Le mouvement national palestinien ne s’est jamais, au
cours de son histoire, situé dans un rejet moral de la violence.
Lorsqu’au milieu des années 1980 Mubarak Awad fonde le
« Centre d’étude de la non-violence », à Jérusalem, il précise dans
le document fondateur que la stratégie non-violente est une question de
conjoncture, et qu’elle « n’exclut pas
la possibilité que la lutte à l’intérieur [des territoires
palestiniens] se transforme en lutte armée lors d’une prochaine
étape »(13). À l’exception du Parti du Peuple Palestinien (PPP,
ex-Parti Communiste Palestinien), aucune des principales
organisations politiques palestiniennes n’a même, à ce jour, renoncé en
principe à l’action violente. Et le PPP explique sa position non
par des raisons philosophiques mais par des raisons pragmatiques :
la nécessité de construire une résistance populaire « de masse »,
incompatible selon eux avec toute
militarisation de la lutte.
Les
débats inter-palestiniens quant aux questions de principe concernant
« la » violence, touchent donc
quasi-exclusivement les attaques contre les civils : attentats et
prises d’otages dans les années 1970-1980, « attentats-suicide » en
Israël dans les années 1990-2000. Et ici
encore, le débat ne se situe guère sur le terrain moral mais sur
celui de l’efficacité politique : lorsque dans les années 1980 Yasser
Arafat affirme « renoncer au terrorisme »,
c’est pour que l’OLP soit reconnue comme un partenaire légitime dans
le cadre d’un processus négocié ; lorsqu’en juin 2002 une pétition
d’intellectuels palestiniens appelle à l’arrêt des
attentats-suicide, c’est « [parce que] ces
opérations n’avancent pas [les Palestiniens] sur la voie de la liberté
et de l'indépendance, mais gonflent les
rangs des opposants à la paix et donnent au gouvernement de Sharon
des arguments pour poursuivre sa guerre destructrice »(14). Ce
débat sur les actions violentes contre les civils
(distingués des soldats et des colons) appelle deux remarques : il
traduit en réalité un débat plus profond quant à la légitimité de l’État
d’Israël, certains courants palestiniens,
notamment le Hamas (même s’il a nuancé, ce dernières années, ses
positions(15)), considérant qu’il n’y a pas de civils israéliens, mais
seulement des colons ; sa place et sa teneur indiquent
en outre que dans la stratégie palestinienne le problème n’est pas
l’opposition « violence/non-violence », mais davantage la question de
savoir quelle place et quelle forme doit prendre
la résistance armée dans la lutte plus globale.
Ces éléments permettent de comprendre pourquoi le terme « non-violence » n’est que très rarement
employé dans les territoires et le champ politique palestiniens. Le concept de « non-violence » opère, de facto,
une rupture entre deux formes de résistance qui n’ont jamais
été pensées par les Palestiniens comme étant contradictoires mais
complémentaires. On parlera donc de « résistance populaire » et de
« résistance armée », on privilégiera la
réflexion sur l’articulation entre les deux modes d’action, et non
sur la supériorité de l’un vis-à-vis de l’autre. On comprend dès lors
mieux les décalages manifestes, voire les
incompréhensions, entre les Palestiniens eux-mêmes et ceux qui
affirment les soutenir dans leur combat tout en conditionnant ce soutien
à « l’arrêt des violences » :
- pour les Palestiniens le mot d’ordre de « l’arrêt des violences » ne prend son sens que dans la
mesure où l’on parle de l’ensemble des violences, y compris l’occupation civile et militaire.
- la « résistance non-violente », que les Palestiniens appellent « résistance populaire »,
n’est pas pour ces derniers en contradiction avec la lutte armée.
- les discussions sur les moyens privilégiés de la lutte n’ont de valeur, pour les Palestiniens, que si elles
s’inscrivent dans la recherche du moyen le plus efficace pour satisfaire leurs droits.
III) Une stratégie nouvelle ?
Ainsi, loin d’être un changement de stratégie issu d’un quelconque aggiornamento
des organisations
politiques palestiniennes, l’apparente nouveauté des formes
« non-violentes » de résistance dans les territoires palestiniens est
avant tout le produit d’une illusion d’optique. La
quasi-hégémonie idéologique du paradigme du « cycle de la
violence », combiné à l’occultation, volontaire ou non, de la violence
quotidienne de l’occupation israélienne, a invisibilisé
l’essentiel de la résistance palestinienne. De même que certains
avaient découvert la nature populaire et non-violente de la résistance
palestinienne lors de l’Intifada de 1987, d’autres
(parfois les mêmes) ont oublié ces caractéristiques lorsque, dans
les années 2000-2004, l’ensemble des organisations palestiniennes (à
l’exception du PPP) ont repris la lutte armée. Cette myopie
a conduit certains acteurs étatiques ou extra-étatiques à
relativiser leur soutien à la lutte palestinienne, les plaçant dans la
position paradoxale de soutien aux droits d’un peuple sans soutien
à son combat.
Confrontés
au triple défi de l’écrasement militaire, de l’isolement international
et des divisions entre
organisations palestiniennes, divers cadres du mouvement national
palestinien ont eu l’intelligence politique de mettre en avant une lutte
locale exemplaire, celle des villageois de Bil’in, et de
lancer un appel international à une action « non-violente » contre
Israël, l’appel BDS. Ce faisant, ils ont contribué à la reconquête de la
légitimité palestinienne, sans pour autant
revendiquer une quelconque nouveauté ou une concurrence avec les
formes armées de la lutte. Sans jamais se réclamer d’une non-violence
philosophique, de principe, qui ne peut naître et/ou prendre
racine dans une société confrontée de manière quotidienne à la
violence de l’occupation, les organisations palestiniennes qui se sont
saisies de l’écho international de Bil’in et/ou qui ont
participé à l’initiative BDS ont progressivement redonné son sens et
son audience à la résistance populaire, qui n’avait en réalité jamais
disparu des territoires palestiniens. Ils ont ainsi
démontré que l’opposition formelle entre partisans et adversaires de
la violence était une construction idéologique exogène vouée à
dissimuler une rhétorique du « partage des
responsabilités » entre Israël et les Palestiniens.
 Ce
faisant, ces acteurs ont redonné un contenu au concept de résistance
non-violente, qui ne s’est
jamais au cours de l’Histoire limité à un pacifisme souvent synonyme
d’inaction(16). On comprend dès lors pourquoi le terme de résistance
populaire, « à la base », est privilégié, qui
ne se définit pas « en négatif » par rapport à un possible recours à
la violence mais « en positif », sans exclure a priori
l’action violente : implication
toujours plus grande des populations concernées, multiplication des
formes d’action (manifestations, grèves, boycott), et surtout appel à la
participation populaire internationale. C’est donc
essentiellement à une adaptation tactique que l’on a assisté dans
les territoires palestiniens, dont la portée dépasse de très loin le cas
de Bil’in ou de l’appel BDS. Ce dernier s’inscrit en
réalité dans une longue histoire, celle de la résistance
« populaire », et n’est que la traduction sur le plan international du
type de lutte envisagé, depuis plus d’un siècle, par les
Palestiniens eux-mêmes : il s’agit en effet, par des actions de
désobéissance civique, de boycott ou de pression populaire sur des
institutions coopérant avec l’État d’Israël, de contraindre
ce dernier à respecter le droit international et à cesser de nier
les droits nationaux des Palestiniens.
Ce
faisant, ces acteurs ont redonné un contenu au concept de résistance
non-violente, qui ne s’est
jamais au cours de l’Histoire limité à un pacifisme souvent synonyme
d’inaction(16). On comprend dès lors pourquoi le terme de résistance
populaire, « à la base », est privilégié, qui
ne se définit pas « en négatif » par rapport à un possible recours à
la violence mais « en positif », sans exclure a priori
l’action violente : implication
toujours plus grande des populations concernées, multiplication des
formes d’action (manifestations, grèves, boycott), et surtout appel à la
participation populaire internationale. C’est donc
essentiellement à une adaptation tactique que l’on a assisté dans
les territoires palestiniens, dont la portée dépasse de très loin le cas
de Bil’in ou de l’appel BDS. Ce dernier s’inscrit en
réalité dans une longue histoire, celle de la résistance
« populaire », et n’est que la traduction sur le plan international du
type de lutte envisagé, depuis plus d’un siècle, par les
Palestiniens eux-mêmes : il s’agit en effet, par des actions de
désobéissance civique, de boycott ou de pression populaire sur des
institutions coopérant avec l’État d’Israël, de contraindre
ce dernier à respecter le droit international et à cesser de nier
les droits nationaux des Palestiniens.
Si
l’appel BDS se singularise dans l’histoire de la résistance
« populaire » en ceci qu’il est avant
tout à destination d’acteurs extérieurs, il fait néanmoins preuve
d’un remarquable continuité politique avec l’histoire de la lutte
palestinienne. Il réaffirme en effet la nécessité d’une
jonction entre pression intérieure et extérieure sur l’État d’Israël
et, tout en valorisant le caractère non-violent de la stratégie BDS, ne
porte aucun jugement dépréciatif sur le recours à la
lutte armée, qu’il soit passé, présent ou à venir. Le soutien de
l’ensemble des organisations politiques palestiniennes à l’appel, y
compris celles qui n’ont jamais renoncé formellement à la
lutte armée, et continuent parfois de la pratiquer, confirme que
l’opposition irréductible entre « violence » et « non-violence » n’a pas
de pertinence dans le cas palestinien
et ne trouve guère d’écho chez les acteurs du mouvement national.
Les vives critiques formulées contre la campagne BDS, souvent par
ceux-là même qui exigeaient des Palestiniens qu’ils
« arrêtent les violences », sont la démonstration, en miroir, que
cette rhétorique en vogue au début des années 2000 était en réalité une
critique à peine dissimulée de la résistance
palestinienne dans son ensemble. L’appel BDS rappelle ainsi à chacun
que la dénonciation de « la » violence, décontextualisée et
dépolitisée, dissimule mal les indépassables
contradictions d’une approche dite « équilibrée » mais qui tente en
réalité de concilier justice et injustice, droit et non-droit,
oppression et émancipation.
_________________________
Voir à ce sujet mon article « La résistance
non-violente » dans les territoires palestiniens : changement de
stratégie ou recherche d’une légitimité nouvelle ? », dans Julien
Salingue, À la recherche de la
Palestine, Paris, Éditions du Cygne, 2011, p. 119-140, duquel cette contribution est très largement inspirée.




 Khalifa Haftar, joker américain en Libye
Khalifa Haftar, joker américain en Libye

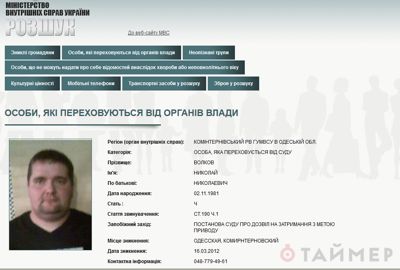

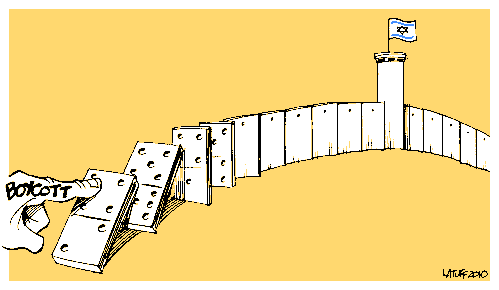 Depuis septembre 2000 et le début de ce que l’on a nommé « deuxième Intifada »,
l’une des approches dominantes dans l’appréhension du conflit
opposant l’État d’Israël au peuple palestinien est celle du « cycle de
la violence » : les violences des uns
succèderaient aux violences des autres, l’enjeu majeur serait donc
la rupture du « cycle opération armée israélienne/représailles
palestiniennes » (ou l’inverse). Ainsi se succèdent, de
manière cyclique également, les appels à « l’arrêt des violences »,
posé comme préalable au dialogue en vue d’hypothétiques négociations
entre les deux parties. Il ne s’agira pas ici de
discuter de la pertinence d’une approche qui place sur le même plan
la « violence » d’un État constitué, possédant une armée suréquipée et
l’arme nucléaire, et celle d’un peuple en
lutte pour son indépendance. Il s’agira plutôt d’interroger les
angles morts, les points aveugles d’une telle approche, et de se
demander dans quelle mesure le discours dominant sur
« la » violence dans les territoires occupés reconfigure, à
l’extérieur, la perception de la lutte nationale du peuple palestinien
et, à l’intérieur, la résistance palestinienne
elle-même.
Depuis septembre 2000 et le début de ce que l’on a nommé « deuxième Intifada »,
l’une des approches dominantes dans l’appréhension du conflit
opposant l’État d’Israël au peuple palestinien est celle du « cycle de
la violence » : les violences des uns
succèderaient aux violences des autres, l’enjeu majeur serait donc
la rupture du « cycle opération armée israélienne/représailles
palestiniennes » (ou l’inverse). Ainsi se succèdent, de
manière cyclique également, les appels à « l’arrêt des violences »,
posé comme préalable au dialogue en vue d’hypothétiques négociations
entre les deux parties. Il ne s’agira pas ici de
discuter de la pertinence d’une approche qui place sur le même plan
la « violence » d’un État constitué, possédant une armée suréquipée et
l’arme nucléaire, et celle d’un peuple en
lutte pour son indépendance. Il s’agira plutôt d’interroger les
angles morts, les points aveugles d’une telle approche, et de se
demander dans quelle mesure le discours dominant sur
« la » violence dans les territoires occupés reconfigure, à
l’extérieur, la perception de la lutte nationale du peuple palestinien
et, à l’intérieur, la résistance palestinienne
elle-même. On peut distinguer, chez les théoriciens et les adeptes de la non-violence, deux grandes postures : la non-violence comme
principe philosophique, découlant d’un rejet a priori de
toute forme d’action violente ; la non-violence comme choix pragmatique,
résultant d’une évaluation de divers modes d’action
dans un cas précis et un contexte donné. Gandhi est probablement le
plus célèbre « philosophe de la non-violence », tandis que Gene Sharp,
parfois surnommé, le « Clausewitz de
la lutte non-violente », incarne la non-violence pragmatique. Tandis
que Gandhi écrit « [que] la non-violence est la loi de notre espèce
tout comme la violence est la loi de
l’animal »(8), se situant délibérément sur le terrain moral, Gene
Sharp affirme que la non-violence est « une réponse à la question de
savoir comment agir avec efficacité en
politique »(9). Les deux approches peuvent bien évidemment être
combinées, et revêtent ici essentiellement un caractère idéal-typique.
On pourra néanmoins aisément comprendre que si
l’approche morale et l’approche pragmatique peuvent parfois
coexister, elles peuvent aussi se révéler contradictoires.
On peut distinguer, chez les théoriciens et les adeptes de la non-violence, deux grandes postures : la non-violence comme
principe philosophique, découlant d’un rejet a priori de
toute forme d’action violente ; la non-violence comme choix pragmatique,
résultant d’une évaluation de divers modes d’action
dans un cas précis et un contexte donné. Gandhi est probablement le
plus célèbre « philosophe de la non-violence », tandis que Gene Sharp,
parfois surnommé, le « Clausewitz de
la lutte non-violente », incarne la non-violence pragmatique. Tandis
que Gandhi écrit « [que] la non-violence est la loi de notre espèce
tout comme la violence est la loi de
l’animal »(8), se situant délibérément sur le terrain moral, Gene
Sharp affirme que la non-violence est « une réponse à la question de
savoir comment agir avec efficacité en
politique »(9). Les deux approches peuvent bien évidemment être
combinées, et revêtent ici essentiellement un caractère idéal-typique.
On pourra néanmoins aisément comprendre que si
l’approche morale et l’approche pragmatique peuvent parfois
coexister, elles peuvent aussi se révéler contradictoires. Ce
faisant, ces acteurs ont redonné un contenu au concept de résistance
non-violente, qui ne s’est
jamais au cours de l’Histoire limité à un pacifisme souvent synonyme
d’inaction(16). On comprend dès lors pourquoi le terme de résistance
populaire, « à la base », est privilégié, qui
ne se définit pas « en négatif » par rapport à un possible recours à
la violence mais « en positif », sans exclure a priori
l’action violente : implication
toujours plus grande des populations concernées, multiplication des
formes d’action (manifestations, grèves, boycott), et surtout appel à la
participation populaire internationale. C’est donc
essentiellement à une adaptation tactique que l’on a assisté dans
les territoires palestiniens, dont la portée dépasse de très loin le cas
de Bil’in ou de l’appel BDS. Ce dernier s’inscrit en
réalité dans une longue histoire, celle de la résistance
« populaire », et n’est que la traduction sur le plan international du
type de lutte envisagé, depuis plus d’un siècle, par les
Palestiniens eux-mêmes : il s’agit en effet, par des actions de
désobéissance civique, de boycott ou de pression populaire sur des
institutions coopérant avec l’État d’Israël, de contraindre
ce dernier à respecter le droit international et à cesser de nier
les droits nationaux des Palestiniens.
Ce
faisant, ces acteurs ont redonné un contenu au concept de résistance
non-violente, qui ne s’est
jamais au cours de l’Histoire limité à un pacifisme souvent synonyme
d’inaction(16). On comprend dès lors pourquoi le terme de résistance
populaire, « à la base », est privilégié, qui
ne se définit pas « en négatif » par rapport à un possible recours à
la violence mais « en positif », sans exclure a priori
l’action violente : implication
toujours plus grande des populations concernées, multiplication des
formes d’action (manifestations, grèves, boycott), et surtout appel à la
participation populaire internationale. C’est donc
essentiellement à une adaptation tactique que l’on a assisté dans
les territoires palestiniens, dont la portée dépasse de très loin le cas
de Bil’in ou de l’appel BDS. Ce dernier s’inscrit en
réalité dans une longue histoire, celle de la résistance
« populaire », et n’est que la traduction sur le plan international du
type de lutte envisagé, depuis plus d’un siècle, par les
Palestiniens eux-mêmes : il s’agit en effet, par des actions de
désobéissance civique, de boycott ou de pression populaire sur des
institutions coopérant avec l’État d’Israël, de contraindre
ce dernier à respecter le droit international et à cesser de nier
les droits nationaux des Palestiniens.




