Les dynamiques économiques dans les territoires palestiniens (1967-2010)
Intégration inégale, de-development et économie-casino
NB : le texte qui suit est l'extrait d'un article publié dans un ouvrage collectif qui vient de paraître aux éditions l'Harmattan : Quel Etat ? Pour quelle Palestine ? (Sous la direction de Rapahaël Porteilla, Jacques Fontaine, Philippe Icard et André Larceneux). L'ouvrage est présenté à la fin de cet extrait.
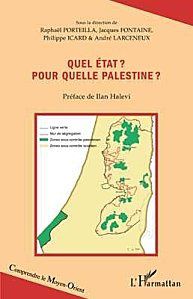
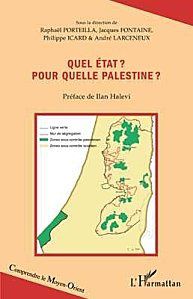
« Si les Palestiniens et les Israéliens parvenaient à un accord permettant de développer les échanges économiques et de construire un système économique viable à Gaza et en Cisjordanie, ce serait la solution la plus appropriée pour rétablir la confiance entre les deux parties »[1].
« Aujourd’hui en Palestine il y a de réelles opportunités pour faire des affaires »[2].
L’année 2007 semble avoir marqué un changement dans la gestion de la question palestinienne. C’est en effet depuis lors que la rhétorique de la « paix économique » entre Israël et les Palestiniens domine, tant chez Tony Blair (envoyé spécial du « Quartet pour le Proche-Orient ») que chez Salam Fayyad (Premier Ministre palestinien) et ses homologues israéliens (Ehud Olmert puis Benyamin Netanyahu).
La philosophie générale de la doctrine de la « paix économique » est la suivante : le préalable à tout règlement négocié du conflit entre Israël et les Palestiniens est une amélioration significative des conditions économiques dans lesquelles évoluent ces derniers ; la priorité doit donc être mise sur des mesures israéliennes permettant un meilleur développement économique dans les territoires palestiniens et sur un renforcement du soutien des pays donateurs à l’économie palestinienne.
Dans un tel contexte, et avant même de se poser la question de la pertinence, ou non, d’une telle approche, il me semble nécessaire d’interroger les réalités économiques dans lesquelles s’inscrit cette nouvelle doctrine. En d’autres termes il est indispensable, pour penser la situation actuelle de l’économie palestinienne et ses hypothétiques évolutions, de cerner les dynamiques économiques dans les territoires palestiniens au cours des dernières décennies.
Parler de ces dynamiques économiques est un véritable défi qui pose, d’emblée, le problème de la pertinence et de l’opérabilité des concepts. Pour le dire avec une formule volontairement provocatrice : dans quelle mesure peut-on parler d’une « économie palestinienne » ?
Si l’on entend l’économie palestinienne comme l’activité économique des territoires palestiniens (production, consommation, échange et commerce de biens et de services), la question est dénuée de sens : cette activité, comme dans tout ensemble social, existe. Mais si l’on entend l’économie palestinienne comme un système économique palestinien et/ou comme une activité n’existant pas seulement en soi mais pour soi, les choses sont beaucoup plus complexes.
En effet, s’interroger sur l’état de l’économie palestinienne n’est pas s’interroger sur une économie « classique ». Les Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza, issus d’une société dispersée et déstructurée en 1947-1948, vivent sous occupation militaire depuis plus de 60 ans. Penser l’économie palestinienne, c’est penser l’occupation israélienne et ses répercussions économiques, c’est penser les ruptures et les continuités au sein du processus d’Oslo et c’est, enfin, mettre en perspective la situation et les dynamiques actuelles en interrogeant la « stratégie économique palestinienne » depuis Oslo et la « doctrine Fayyad ».
1) Une économie (dé-)structurée par l’occupation militaire
a) L’intégration inégale
Après la guerre des 6 jours (juin 1967) et la prise de contrôle de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza, Israël gouverne les territoires palestiniens occupés au moyen d’ordres militaires. Ces ordres militaires régentent tous les domaines de la vie des Palestiniens, allant même jusqu’à réglementer le type et la quantité de plantes décoratives en Cisjordanie et à Gaza (ordre n°818) ou à interdire la publication des résolutions des Nations Unies concernant la Palestine (ordre n°1079).
La thèse que je défends ici est qu’il n’y a pas seulement eu des « conséquences économiques de l’occupation israélienne », mais bien une « stratégie économique israélienne » à l’égard des territoires occupés. Comment comprendre, sinon, que plus de 50% des ordres militaires émis dans la période 1967-1993 soient en relation directe avec les questions économiques [3]?
Il ne s’agira pas ici d’entrer dans le détail de ces ordres, mais plutôt d’en dégager les « tendances lourdes » et leur implication quant aux évolutions de l’économie palestinienne durant la période allant de 1967 aux Accords d’Oslo.
La tendance générale est celle d’une intégration inégale de l’économie palestinienne à l’économie israélienne. « Intégration inégale » signifie ici qu’il n’y a pas eu de fusion entre les deux économies ou d’absorption de l’économie palestinienne par l’économie israélienne. C’est à un processus de prise de contrôle/reconfiguration que l’on assiste, dans un rapport de subordination de l’économie palestinienne à l’économie israélienne.
C’est ainsi, par exemple, que par les ordres numéros 10, 11 et 12 (juin 1967) Israël rend illégaux tous les accords préalablement existants quant aux importations et exportations vers et depuis les territoires palestiniens, contraignant non seulement les commerçants mais aussi les négociants en matières premières à importer des produits israéliens.
De telles mesures ont des répercussions au niveau de l’ensemble du secteur industriel : tous les acteurs palestiniens deviennent dépendants des productions israéliennes. A partir de 1967, entre 90 et 95% des importations dans les territoires palestiniens proviennent d’Israël.
La circulation des marchandises au sein des territoires palestiniens est elle aussi soumise à des autorisations israéliennes. Suite à l’ordre militaire n°49, les agriculteurs palestiniens sont obligés de demander une permission aux autorités militaires israéliennes pour faire entrer leurs produits dans une « zone fermée ».
La panoplie des ordres militaires israéliens concerne progressivement l’ensemble de la vie économique des territoires occupés. La création de toute nouvelle entreprise est ainsi soumise à l’approbation de la puissance occupante (ordre militaire n°267, modifié par les ordres n°362 et 398), tout comme l’enregistrement de toute nouvelle marque (ordre n°379, modifié par l’ordre n°398) ou la plantation d’arbres fruitiers (ordre n°1015).
Grâce à cette emprise indirecte sur les structures économiques palestiniennes, Israël va pouvoir accélérer la spécialisation de son industrie dans les domaines de pointe tout en « favorisant » le développement, dans les territoires occupés, de productions à faible valeur ajoutée et peu modernes :
« Au milieu des années 1960, Israël entama une mutation industrielle en vue d'une spécialisation dans les industries électroniques et militaires de pointe, afin de s'adapter à la division internationale du travail qui conduisait les pays développés à une spécialisation [dans l'industrie] technologique. C'est la raison pour laquelle [il] mit moins l'accent sur nombre de ses industries traditionnelles comme le textile, les chaussures ou les produits chimiques. Les territoires occupés firent face à un processus de délocalisation industrielle, à leur détriment. Tandis qu'Israël se concentrait sur des secteurs industriels d'avenir, les territoires occupés durent se contenter de secteurs de production d'un niveau technologique inférieur et avec moins de perspectives de croissance, une situation qui maintint le fossé économique [entre eux et Israël] »[4].
On assiste ainsi, dans des domaines comme l’industrie textile ou la production de chaussures, à la mise en place de réseaux de sous-traitance dans les territoires palestiniens : des industriels israéliens y transfèrent les premières étapes de leur chaîne de production avant de revendre les produits finis sous l’étiquette « made in Israel ».
Israël se prémunit en outre du développement d’une économie concurrentielle dans les territoires palestiniens, réduisant considérablement la production agricole par les confiscations de terres (ordres militaires n°58, 59, 291, 321, 364, 1091…) et la prise de contrôle des ressources aquifères (ordres n°92, 291…), et empêchant la mise en place d’une industrie moderne. C’est ainsi qu’en 1990 la production industrielle représente à peine 8% du PNB palestinien (contre 25% en Jordanie) et que la taille moyenne d’une entreprise palestinienne est de 4 salariés (soit le même chiffre qu’en 1927), tandis que les terres agricoles les plus fertiles et les plus rentables ont été confisquées pour l’agriculture israélienne.
Cette politique va contraindre des centaines de milliers de Palestiniens à rechercher du travail à l’extérieur des territoires occupés, tout d’abord dans les pays pétroliers puis en Israël même. Entre 1970 et 1990 la force de travail augmente de 64% tandis que les emplois à l’intérieur des territoires occupés n’augmentent que de 28%. Au début des années 90, près de la moitié de la main d’œuvre travaille à l’extérieur, et environ 25% du PNB des territoires occupés est dérivé des revenus des travailleurs palestiniens en Israël.
b) Le modèle du de-development
De manière plus modélisée, 4 grandes tendances se dégagent[5] :
- Une économie totalement périphérisée, avec pour unique centre l’Etat d’Israël. Les villes palestiniennes sont dans une relation de dépendance économique directe avec Israël, et elles ne constituent même pas un « centre » pour les villages aux alentours, eux aussi dans un rapport de subordination directe.
- Une économie qui ne maîtrise pas ses priorités en termes d’investissement et de développement. Tout investissement et projet de développement étant soumis à l’approbation israélienne, il s’inscrit nécessairement dans le cadre de l’intégration inégale. La plupart des investissements s’effectueront donc logiquement dans le secteur foncier, domaine qui ne peut guère bouleverser les « équilibres » économiques.
- Une économie dans laquelle les capitaux sont encouragés à fuir : en 1967 Israël ferme toutes les banques et les remplace progressivement par des banques commerciales israéliennes. Peu enclins à confier leur argent à ces banques, les Palestiniens ont eu tendance à placer leur argent à l’étranger, ce qui a contribué à ralentir le développement économique, tout comme l’absence de système de crédit.
- Enfin, une économie captive de l’économie israélienne, tant du point de vue des importations que des exportations : les producteurs et marchands se sont adaptés aux besoins de l’économie israélienne ; les exportateurs et les importateurs ont perdu la possibilité d’importer ou d’exporter directement depuis ou vers d’autres pays dans des conditions plus avantageuses.
Cette intégration inégale se concrétise dans un processus que Sara Roy caractérise comme du « de-development »[6], à distinguer du sous-développement, dans lequel les conditions de possibilité d’un développement économique, même subordonné, existent. Le de-development détruit, structurellement, les bases mêmes de tout développement économique réel : il se « définit comme un processus qui sape ou affaiblit la capacité d'une économie à croître et à se développer en l'empêchant d'obtenir et d'utiliser les inputs essentiels et indispensables pour permettre une croissance intérieure au-delà d'un niveau structurel donné » [7].
L’augmentation de la production et du niveau de vie dans les territoires palestiniens, consécutive à l’occupation de 1967, ne s’est pas et ne pouvait, pour les raisons structurelles énoncées ci-dessus, se transformer qualitativement en développement économique global. Le de-development empêche, en définitive, l’émergence d’un système économique palestinien.
a) La logique d’Oslo
b) Les Accords économiques
c) L’arme politique
3) Au-delà de l’occupation, l’échec d’une stratégie palestinienne et internationale
a) Le rôle économique de l’AP
b) De la dépendance économique à la dépendance politique
Conclusion : une faillite programmée ?
[1] Corina Cretu, Vice-présidente de la Commission du Développement au Parlement Européen, audition du 23 mars 2010.
[2] Tony Blair, Haaretz, 16 avril 2008.
[3] Jamil Rabah et Natasha Fairweather,, Israeli Military Orders in the Occupied Palestinian Territories: 1967-1992, Jerusalem Media & Communication Centre, Jérusalem, 1993.
[4] Adel Samara, Palestine : From Historical De-classing to a Stand-by Regime, août 2007, disponible sur http://www.kanaanonline.org/articles/01244.pdf
[5] Ibid
[6] Sara Roy, « The Gaza Strip: A Case of Economic De-Development », Journal of Palestine Studies, Vol. 17, n° 1, 1987, pp. 56-88.
[7] Ibid, p. 56.
________________________________
Présentation de l'ouvrage
Après plus de soixante années d'occupation et de colonisation israéliennes, l'État palestinien a souvent été annoncé, mais jamais réalisé. S'il y a bien présence d'un territoire, celui-ci est réduit et émietté; s'il y a un pouvoir politique, il est contesté et depuis 2007 divisé; s'il y a une vie socioéconomique, elle est dépendante et soumise. Seul demeure un peuple - sûr de son droit - dont plus de la moitié est réfugiée ou exilée, soit sur son propre territoire, soit à l'extérieur. Dans ce contexte, comment fonder cet État, sut quelles réalités socioéconomiques, sur quelles bases constitutionnelles et autour de quel ordre juridique et politique le construire? Ce sont toutes ces questions qu'envisage le présent ouvrage, fruit d'un colloque tenu à Dijon fin novembre 2009.
Table des matières
Remerciements
Liste des contributeurs
Préface
Sommaire
Introduction
PARTIE I : Un Etat suggéré mais jamais réalisé
Appropriation, conquête et colonisation : une histoire revisitée
André Larceneux, L’Etat palestinien et les frontières d’Israël : immigration juive, mythes religieux et idéologie sioniste dans la construction d’un avatar colonial
Gérard Fritz, Le partage de la Palestine (1947-1949)
Jean-Paul Bruckert, Israël et les territoires occupés de la Guerre des six jours (1967) à Oslo (1993)
Le droit international bafoué
Sylviane de Wangen, Une population en exil : les réfugiés palestiniens.
Le statut juridique des réfugiés palestiniens au regard du droit général des réfugiés
Aude Signoles, Les ambiguïtés du processus d’Oslo
Monique Chemillier-Gendreau, Israël et le droit international
Des perceptions contradictoires
Pierre Stambul, L’opinion israélienne et le complexe de Massada
Sarah Bouflija, La politique américaine et l’Etat palestinien : de l’espoir à la déception (1992-2010)
Nicolas Dot-Pouillard, Les mondes arabes et la question palestinienne : appareils étatiques, figures activistes transnationales et « Street Politics »
Pierre Barbancey, Le rôle des médias internationaux
L’Europe frileuse
Alima Boumediene-Thiery, Les accords UE-Israël
Francis Wurtz, La place de l’Union européenne dans la construction d’un Etat Palestinien
PARTIE II : La construction de « l’Etat par le bas » ou la société, vecteur de l’Etat ?
Une situation socio-économique et environnementale délicate
Julien Salingue, Les dynamiques économiques dans les territoires palestiniens (1967-2010) : Intégration inégale, de-developpement et économie-casino
Jacques Fontaine, La politique israélienne de l’eau dan les territoires palestiniens occupés
Jean Claude Fritz, L’environnement en Palestine
Des réalités sociologiques complexes
Emilie Thiriat, Les femmes palestiniennes et la construction de l’Etat palestinien
Souha Mansour-Shehadeh, Système de soins en Palestine : l’exemple de la santé mentale
Georges Solaux, Regards sur l’école Palestinienne. Quelle politique éducative ?
Une architecture politico-juridique en débat
Abeer Mashni-Giroud, Quelle administration ? L’élaboration du système de gouvernement local palestinien
Françoise Dreyfus, Quelle constitution, en attendant l’Etat ?
Asem Khalil, Quel système politique pour la Palestine ? Leçons tirées de la crise politique de l’Autorité Palestinienne et de l’impasse institutionnelle conformément à la Loi Fondamentale
Moussa Abou Ramadan, Les stratégies des cours de Charia à Jérusalem
Bernard Ravenel, Le système politique bipolaire palestinien. Pour une refondation unitaire du mouvement national
Conclusion, Dominique Vidal : Solution bi-étatique ou binationale ?
Glossaire et acronymes
Glossaire des noms propres
Repères chronologiques
Bibliographie
Liste des contributeurs
Préface
Sommaire
Introduction
PARTIE I : Un Etat suggéré mais jamais réalisé
Appropriation, conquête et colonisation : une histoire revisitée
André Larceneux, L’Etat palestinien et les frontières d’Israël : immigration juive, mythes religieux et idéologie sioniste dans la construction d’un avatar colonial
Gérard Fritz, Le partage de la Palestine (1947-1949)
Jean-Paul Bruckert, Israël et les territoires occupés de la Guerre des six jours (1967) à Oslo (1993)
Le droit international bafoué
Sylviane de Wangen, Une population en exil : les réfugiés palestiniens.
Le statut juridique des réfugiés palestiniens au regard du droit général des réfugiés
Aude Signoles, Les ambiguïtés du processus d’Oslo
Monique Chemillier-Gendreau, Israël et le droit international
Des perceptions contradictoires
Pierre Stambul, L’opinion israélienne et le complexe de Massada
Sarah Bouflija, La politique américaine et l’Etat palestinien : de l’espoir à la déception (1992-2010)
Nicolas Dot-Pouillard, Les mondes arabes et la question palestinienne : appareils étatiques, figures activistes transnationales et « Street Politics »
Pierre Barbancey, Le rôle des médias internationaux
L’Europe frileuse
Alima Boumediene-Thiery, Les accords UE-Israël
Francis Wurtz, La place de l’Union européenne dans la construction d’un Etat Palestinien
PARTIE II : La construction de « l’Etat par le bas » ou la société, vecteur de l’Etat ?
Une situation socio-économique et environnementale délicate
Julien Salingue, Les dynamiques économiques dans les territoires palestiniens (1967-2010) : Intégration inégale, de-developpement et économie-casino
Jacques Fontaine, La politique israélienne de l’eau dan les territoires palestiniens occupés
Jean Claude Fritz, L’environnement en Palestine
Des réalités sociologiques complexes
Emilie Thiriat, Les femmes palestiniennes et la construction de l’Etat palestinien
Souha Mansour-Shehadeh, Système de soins en Palestine : l’exemple de la santé mentale
Georges Solaux, Regards sur l’école Palestinienne. Quelle politique éducative ?
Une architecture politico-juridique en débat
Abeer Mashni-Giroud, Quelle administration ? L’élaboration du système de gouvernement local palestinien
Françoise Dreyfus, Quelle constitution, en attendant l’Etat ?
Asem Khalil, Quel système politique pour la Palestine ? Leçons tirées de la crise politique de l’Autorité Palestinienne et de l’impasse institutionnelle conformément à la Loi Fondamentale
Moussa Abou Ramadan, Les stratégies des cours de Charia à Jérusalem
Bernard Ravenel, Le système politique bipolaire palestinien. Pour une refondation unitaire du mouvement national
Conclusion, Dominique Vidal : Solution bi-étatique ou binationale ?
Glossaire et acronymes
Glossaire des noms propres
Repères chronologiques
Bibliographie
____________________________________________________________________________________________________
BON DE COMMANDE
A retourner à L’HARMATTAN, 7 rue de l’Ecole Polytechnique 75005 Paris
Veuillez me faire parvenir ....... exemplaire(s) du livre « Quel Etat ? Pour quelle Palestine ? » au prix unitaire de 40€ + 4€ de frais de port, + 0,80€ de frais de port par ouvrage supplémentaire, soit un total de ......... €.
NOM :
ADRESSE :
Ci-joint un chèque de ............ €.
Pour l’étranger, vos règlements sont à effectuer:
- en euros sur chèques domiciliés sur banque française.
- par virement en euros sur notre CCP 20041 00001 2362544 N 020 11 Paris
- par carte bancaire Visa N°................................ date d’expiration...../...../...../ et le numéro CVx2 (les 3 derniers chiffres au dos de votre carte, à gauche de votre signature) :…………………………………






Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire